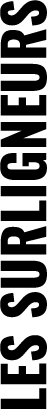Covid-19 : État de guerre sanitaire, mais pas d'”état d’urgence”
Dernière modification : 20 juin 2022
Auteur : Jean-Paul Markus, professeur de droit public, Université Paris-Saclay
Médicalement, le discours des épidémiologistes évoque bien une guerre contre un ennemi omniprésent, avec une stratégie globale et des tactiques locales. Si la part irréductible d’improvisation juridique est liée à l’improvisation du corps médical lui-même face au péril, il n’empêche qu’il existe en France un dispositif légal et réglementaire suffisamment souple pour répondre aux impératifs de santé publique. Faut-il en ajouter une couche ?
« Guerre sanitaire » ou, en droit, « police de la santé publique »
Cette police est basée sur l’article L1311-1 du code de la santé publique : des décrets en Conseil d’État « fixent les règles générales d’hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l’homme, notamment en matière (…) de prévention des maladies transmissibles ». Sur cette base, des décrets fixent des mesures pérennes, destinées à protéger la santé publique, dans tous les domaines, dès qu’un risque sur la santé est identifié. Par exemple, lorsque la mode des tatouages et arrivée, avec son lot de tatoueurs aussi dangereux qu’amateurs, un décret en 2008 est intervenu pour fixer « les conditions d’hygiène et de salubrité relatives aux pratiques du tatouage avec effraction cutanée et du perçage ».
En cas de « menace sanitaire grave », prévoit le code de la santé publique, des « mesures d’urgence » peuvent être prises par arrêté du ministre de la santé. Ces arrêtés prescrivent « toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces ». Sur cette base ont été pris plusieurs arrêtés depuis le début de l’épidémie, portant fermeture des écoles, commerces, interdiction des réunions massives, etc. On recense au Journal Officiel huit arrêtés en l’espace de deux semaines, depuis le 4 mars. Le premier interdisait les rassemblements de plus de 5000 personnes, le dernier en date prévoit entre autres que les pharmacies distribuent gratuitement des masques aux professionnels de santé. Entretemps, on passait de 5000 personnes à 1000, avant qu’intervienne le décret, daté du 16 mars, publié ce matin. Ce décret met en place le confinement, c’est-à-dire, en termes juridiques, qu’il « interdit (…) le déplacement de toute personne hors de son domicile » jusqu’au 31 mars, sauf exception justifiée. Il s’agit d’un décret alors que l’article L. 3131-1 prévoit des arrêtés, mais il faut y voir la volonté du gouvernement de marquer la gravité de la situation : personne n’ira exercer de recours sur ce motif, d’autant que nous sommes dans un contexte de circonstances exceptionnelles.
Parallèlement, les préfets et les maires pourront agir sur la base de leurs propres pouvoirs de police générale pour adapter les règles aux situations locales, les rendre encore plus sévères notamment. C’est le droit commun de la police, prévu par le code général des collectivités territoriales (articles L. 2212-2 et L. 2215-1). C’est ce qui se passe dans les régions fortement touchées par le Covid-19. D’autres autorités de police interviennent, comme l’Agence nationale de sécurité du médicament, qui vient de limiter les ventes de paracétamol afin d’éviter les ruptures d’approvisionnement, sur la base du code de la santé publique (art. L. 5311-1 et L. 5312-1).
Enfin, le code pénal prévoit une sanction pour les contrevenants à tous ces arrêtés de police : « la violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 1re classe », soit 38 euros. Ce montant devrait être relevé par décret à 135 euros, selon les dires du ministre de l’Intérieur.
Jusqu’où cette « guerre » peut aller en droit ?
Comme toutes les mesures de police administrative, les mesures d’urgence sanitaires portent atteinte aux libertés, et en l’occurrence la liberté d’aller et venir. Elles doivent donc être proportionnées au danger encouru. C’est la jurisprudence Benjamin de 1933 qui est toujours valable et qui a beaucoup servi lors des manifestations des gilets jaunes. À ce jour, aucune voix ne semble s’élever pour dénoncer une disproportion. Cela signifie que si le danger s’accentue, l’atteinte aux libertés pourra encore être aggravée. On peut imaginer des interdictions totales de sortie du domicile, la fermeture des transports en commun, ainsi que celle des routes (avec des dérogations). Les militaires peuvent être appelés en renfort afin de surveiller l’application de ces interdictions, mais sans pouvoirs de police.
La sanction pénale pour non-respect des interdictions peut également être aggravée au point d’un faire un délit. Il faudrait alors une loi, ou une ordonnance de l’article 38 de la Constitution, prise sur la base d’une loi d’habilitation, laquelle devrait d’ailleurs être votée dans les prochains jours. Par comparaison, dans d’autres pays démocratiques (Italie, Israël), le non-respect des mesures de confinement peut entraîner des peines de prison, ce qui se justifie par le fait que le contrevenant met les autres en danger.
Enfin, et au-delà d’un stade qui ne semble pas atteint, la question du déclenchement de l’état d’urgence a été soulevée. La propagation du Covid-19 constitue-t-elle un « péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public » ou un événement présentant, par sa nature et sa gravité, le caractère d’une « calamité publique » ? L’état d’urgence n’a été déclaré à ce jour que pour des troubles à la sécurité publique, les plus récents étant les attentats de 2015 et les plus anciens la guerre d’Algérie. Bien qu’elle n’ait jamais été utilisée pour cela, la notion de « calamité publique » englobe aussi les phénomènes naturels dévastateurs comme les tremblements de terre, cyclones, raz de marée, etc., ou encore des accidents industriels aux répercussions majeures (ex. : un accident nucléaire). Tous ces périls sont de nature à favoriser des troubles additionnels à l’ordre public comme des pillages, ce qui justifie aussi l’état d’urgence.
C’est pourquoi l’état d’urgence semble bien exclu : urgence sanitaire ne rime pas avec état d’urgence car l’ennemi n’est pas le même : l’état d’urgence est un instrument de rétablissement de la sécurité publique alors que l’urgence sanitaire commande des mesures de protection de la santé publique. L’état d’urgence renforce les pouvoirs de la police judiciaire (avec par exemple les perquisitions et les contrôles d’identité facilités, des assignations à résidence), autant d’outils inutiles contre une pandémie. L’état d’urgence permet également un couvre-feu, mais la police générale aussi.
Ou alors… on verse dans le catastrophisme exacerbé : la pandémie devient incontrôlable, les hôpitaux débordés sont eux-mêmes vidés de leurs personnels atteints, les flux de marchandises sont cassés, les vols se propagent, la population panique, etc., et la sécurité est menacée au même titre que la santé. La littérature foisonne de fictions de ce type (L’effondrement de la civilisation occidentale, Erik M. Conway, Naomi Oreskes, éd. Les liens qui libèrent, 2014), mais l’Histoire en a aussi connus (Patrick Zylberman, Crises sanitaires, crises politiques, Revue Les Tribunes de la santé 2012/1,n° 34)…
Une erreur dans ce contenu ? Vous souhaitez soumettre une information à vérifier ? Faites-le nous savoir en utilisant notre formulaire en ligne. Retrouvez notre politique de correction et de soumission d'informations sur la page Notre méthode.