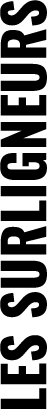Dépénalisation, décriminalisation, pénalisation, etc. : explications
Dernière modification : 17 juin 2022
Autrice : Audrey Darsonville, professeure de droit pénal
Un rapport d’information relatif à l’usage illicite de stupéfiants a été enregistré à l’Assemblée nationale le 25 janvier 2018. Comme à chaque proposition de modification de la législation pénale relative à l’usage de stupéfiants, la question de la dépénalisation de ce délit est soulevée. Mais, qu’entend-on exactement par « dépénalisation » ?
Décriminalisation ou dépénalisation ? La différence.
La décriminalisation consiste pour le législateur à voter une loi qui proclame qu’un acte illicite ne sera plus une infraction à l’avenir. Il s’agit donc de transformer un comportement prohibé en comportement autorisé. Une telle démarche de décriminalisation est rare. On pourra citer par exemple la loi du 11 juillet 1975 qui a supprimé l’infraction d’adultère ou encore la loi du 17 janvier 1975 qui a mis fin à l’infraction d’avortement. La dépénalisation est le fait de la loi, on parle de « dépénalisation légale ». Elle recouvre deux hypothèses. D’abord, elle peut consister en une rétrogradation d’un comportement à l’intérieur du système pénal : un crime devient délit, un délit devient contravention ; il sera donc toujours interdit mais moins sévèrement puni. Ensuite, la dépénalisation peut aussi consister à faire sortir un comportement du droit pénal pour le faire entrer dans une autre sphère juridique (droit civil, droit administratif… pour les passionnés : J. PRADEL, Droit pénal général, ed. Cujas, 2016, p. 25). Le comportement est toujours interdit, mais il sera sanctionné par une autre autorité telle que le juge civil (dommages-intérêts en faveur des victimes), ou encore par une autorité administrative indépendante comme l’Autorité de la concurrence (sanction financière). La dépénalisation est fréquemment utilisée pour transformer des délits routiers en simples contraventions (ex. Loi 30 décembre 1985).
A l’inverse de ces deux mécanismes, décriminalisation et dépénalisation, le législateur peut décider d’une pénalisation, c’est-à-dire de créer une nouvelle infraction. La loi transforme en infraction un comportement qui n’était jusqu’alors pas sanctionné pénalement. Ainsi, une loi de 2016 a créé un nouveau délit (C. pénal, art. 421-2-5-1) qui vise le fait de transmettre des données faisant l’apologie publique d’actes de terrorisme.
Aucune décriminalisation n’est envisagée dans le rapport parlementaire relatif à l’usage de stupéfiants. Aujourd’hui, l’usage de stupéfiants est un délit prévu par le code de la santé publique (art. L. 3421-1), puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. Or, selon le rapport parlementaire, la lutte contre l’usage de stupéfiants est peu efficace et rarement dissuasive. Face à ce constat d’échec, le rapport ne suggère toutefois pas de décriminaliser le délit et donc de faire de l’usage de stupéfiants un acte autorisé en France. Aucune décriminalisation n’est prévue, mais deux autres pistes sont explorées.
La première piste consiste à étendre la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle à l’usage de stupéfiants. L’amende forfaitaire délictuelle a été créée par une loi de 2016 pour les infractions de conduite d’un véhicule sans permis ou sans assurance : avec ce système, l’usage de stupéfiants resterait un délit, mais puni d’une amende au montant fixé à l’avance, et non plus d’une peine d’emprisonnement avec amende variable prononcée par un juge. Reste que la procédure d’amende forfaitaire n’est pas encore applicable faute de publication de l’arrêté d’application. En outre, quel serait le montant de l’amende encourue ? Selon le rapport parlementaire, « Le montant de l’amende forfaitaire délictuelle (devrait) être suffisamment élevé pour rester dissuasif (sous peine sinon de se voir transformer en un simple coût intégré à un comportement de consommation) (…). À l’inverse, un chiffrage trop élevé risquerait de se heurter à l’insolvabilité des usagers ». Une seconde piste serait de contraventionnaliser le délit d’usage de stupéfiants, c’est-à-dire de procéder à une dépénalisation légale.
La dépénalisation légale de l’usage de stupéfiants : d’un délit à une contravention ?
Quand le législateur souhaite qu’un comportement reste interdit tout en le punissant moins sévèrement, il dispose d’une autre option, celle de faire descendre ce comportement dans l’échelle des infractions. En effet, le droit pénal repose sur une distinction bien connue entre trois catégories d’infractions en fonction de leur gravité : les crimes, les délits et les contraventions (C. pénal, article 111-1), les crimes étant les infractions les plus graves. La loi peut ainsi changer une infraction de catégorie. « Correctionnaliser » signifie qu’un crime devient un délit, et « contraventionnaliser » décrit le passage d’un délit en contravention. En matière d’usage de stupéfiants, c’est exactement ce que propose le rapport : le délit deviendrait une contravention forfaitaire de quatrième ou cinquième classe, dont le montant pourrait être compris entre 150 et 200 euros. L’intérêt d’une telle démarche est de simplifier la procédure en établissant une certitude de la sanction pénale pour tout consommateur de stupéfiants interpellé en flagrance.
La « dépénalisation judiciaire » : une pratique du juge confronté à l’encombrement des juridictions pénales : cas du viol.
La dépénalisation judiciaire est une forme de dépénalisation plus contestable, car elle repose sur une simple pratique judiciaire. Cette pratique du juge consiste le plus souvent à correctionnaliser un crime, c’est-à-dire à retenir une qualification délictuelle là où il existe en réalité un crime. En somme, le juge traitera un crime comme un délit. C’est grave au sens où le juge transgresse les lois qui gouvernent la répartition des compétences des juridictions : cette pratique conduit à sanctionner des comportements moins sévèrement que ce que le législateur – expression de la volonté générale – souhaitait.
Or si le juge est souvent conduit à correctionnaliser un crime, c’est pour contourner les cours d’assises qui sont encombrées faute de moyens (délais de jugement très longs). C’est aussi pour épargner à la victime la lourdeur de la procédure aux assises et l’incertitude accrue sur l’issue du procès. À titre d’illustration récente, la correctionnalisation touche massivement le crime de viol, notamment lorsqu’il s’agit de viols conjugaux requalifiés en agression sexuelle (Voir le rapport Les viols dans la chaîne pénale). Les juges justifient cette correctionnalisation par l’objectif de juger plus rapidement ces affaires en évitant les cours d’assises. Or, cette justification est discutable car l’organisation de la justice telle que prévue par la loi suppose que la Cour d’assises connaisse des infractions les plus graves, avec son decorum spécifique et son jury. La solennité du procès d’assises souligne la gravité objective d’un comportement. Sa valeur d’exemplarité – et donc capacité dissuasive – est importante, même si le procès peut aboutir à un acquittement. Or faire juger des comportements criminels par un tribunal correctionnel revient à les banaliser.
Une erreur dans ce contenu ? Vous souhaitez soumettre une information à vérifier ? Faites-le nous savoir en utilisant notre formulaire en ligne. Retrouvez notre politique de correction et de soumission d'informations sur la page Notre méthode.