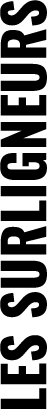L’euthanasie en France
Dernière modification : 17 juin 2022
Auteur : Jean-Paul Markus, professeur de droit
Face aux affaires qui se multiplient devant les juges et à l’approche d’une réforme législative sur la question, il convient de rappeler ce qu’est le droit de l’euthanasie en France et ce qu’il pourrait devenir, étant précisé que le terme « euthanasie » n’existe pas en droit français.
L’arrêt des traitements n’est pas de l’euthanasie. Une des règles éthiques fondamentales de la médecine moderne est d’éviter l’obstination déraisonnable. L’obstination déraisonnable (aussi appelée acharnement thérapeutique ») est interdite par la loi et le code de déontologie des médecins (art. 37). Elle consiste selon la loi à entreprendre ou maintenir des traitements « inutiles ou disproportionnés » ou qui « n’ont d’autres effets que le maintien artificiel de la vie ». Avant d’en arriver à ce stade, les médecins cessent les traitements, en sachant que l’issue sera très probablement la mort du patient. Depuis l’emblématique combat judiciaire autour de Vincent Lambert, qui vit pour la première fois un juge statuer sur la décision médicale d’arrêter les traitements, les cas se sont multipliés, avec dernièrement celui de la jeune Inès, pour laquelle le juge a validé l’arrêt des traitements. À noter que l’arrêt des traitements ne concerne pas que les soins destinés à maintenir la vie, comme l’hydratation et la nutrition artificielles. Le Conseil d’État a également validé la décision de médecins refusant aux parents une chimiothérapie intensive suivie d’une allogreffe de moelle osseuse, au motif que ce traitement ne serait pas supporté par la patiente dont l’état était trop dégradé.
L’arrêt des traitements suit une procédure collégiale ouverte aux proches du patient. La loi dite Clayes-Léonetti du 2 février 2016 encadre strictement la procédure d’arrêt des traitements. Il existe une procédure dite « collégiale » définie par le Code de déontologie médicale, qui oblige le médecin à consulter d’abord les « directives anticipées » de son patient lorsqu’il en a laissées. Toute personne peut en effet stipuler par écrit qu’elle refuse par avance toute obstination déraisonnable. Ce dispositif peut paraître inutile car les médecins ne peuvent pratique l’acharnement thérapeutique. Mais l’intérêt des directives anticipées est de couper court aux litiges qui surviennent entre les médecins et les proches du patient, alors que ce dernier n’est plus en état d’exprimer sa volonté. Toute l’affaire Lambert repose sur l’absence de directives anticipées, et son incapacité à s’exprimer. Durant cette procédure, qui peut être déclenchée à l’initiative des médecins ou des proches, toute l’équipe soignante est sollicitée, mais aussi un médecin extérieur pour avis, et au besoin un second médecin. L’avis des proches est recueilli également, mais il ne lie pas les médecins. Si le patient est mineur, les parents sont bien entendu sollicités, mais pour avis également. Selon le juge, le médecin doit s’efforcer de « dégager une position consensuelle ».
L’arrêt des traitements peut être attaqué devant le juge en référé, mais avec peu de chances de succès. Lorsque la décision issue de cette procédure collégiale tend à l’arrêt des traitements, elle est de plus en plus souvent attaquée devant le juge. Ce dernier s’en remet toujours aux médecins sur le fond, mais il vérifie que la procédure est respectée, notamment la recherche de l’intention du patient. On a déjà vu des cas d’annulation de la décision d’arrêter les traitements pour non-respect de la procédure, y compris dans l’affaire Vincent Lambert. Dans cette affaire d’ailleurs, le juge a obligé l’hôpital à engager la procédure collégiale car les médecins refusaient de le faire en raison d’un climat de tension délétère. Enfin, les motifs religieux invoqués par la famille contre l’arrêt des traitements ne sont pas pris en compte par le juge.
L’arrêt des traitements suppose des traitements palliatifs. Lorsqu’il décide d’arrêter les traitements, le médecin « sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins palliatifs » (Code de la santé publique, art. L. 1110-5-1). Ces soins palliatifs, rendus obligatoires par la loi dite Kouchner du 4 mars 2002, consistent en une « sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès, associée à une analgésie et à l’arrêt de l’ensemble des traitements de maintien en vie » (art. R. 4127-37-3). C’est ce que certaines appellent une euthanasie « passive », au sens où l’équipe médicale ne fait qu’accompagner le mourant, même si la sédation aura certainement pour effet d’accélérer la survenue de la mort. L’absence de soins palliatifs constitue une faute.
L’« euthanasie active » est un crime en l’état actuel du droit, cela pourrait changer. Abréger la vie d’un patient en fin de vie par un poison ou tout autre moyen, même pour limiter ses souffrances, est considérée en France comme un meurtre (C. pénal, art. 221-1). C’est l’affaire Bonnemaison, ce médecin condamné à deux ans avec sursis puis radié de l’ordre. L’aide au suicide, pratiquée en Suisse, sera regardée comme une non-assistance à personne en péril, voire comme un meurtre si la personne malade n’a pas toute sa raison au moment où elle demande à être aidée, notamment du fait de sa maladie. Des voix s’élèvent pour qu’un « droit de mourir » soit consacré. Une proposition de loi de La France Insoumise penche pour la possibilité « d’être euthanasiée » pour la personne qui le demande, ou le « suicide assisté », avec toutefois clause de conscience pour le médecin qui pourrait ainsi refuser en son nom propre. De son côté, le gouvernement attend les résultats d’une consultation nationale sous l’égide du Comité consultatif national d’éthique, ouverte sur internet.
Une erreur dans ce contenu ? Vous souhaitez soumettre une information à vérifier ? Faites-le nous savoir en utilisant notre formulaire en ligne. Retrouvez notre politique de correction et de soumission d'informations sur la page Notre méthode.